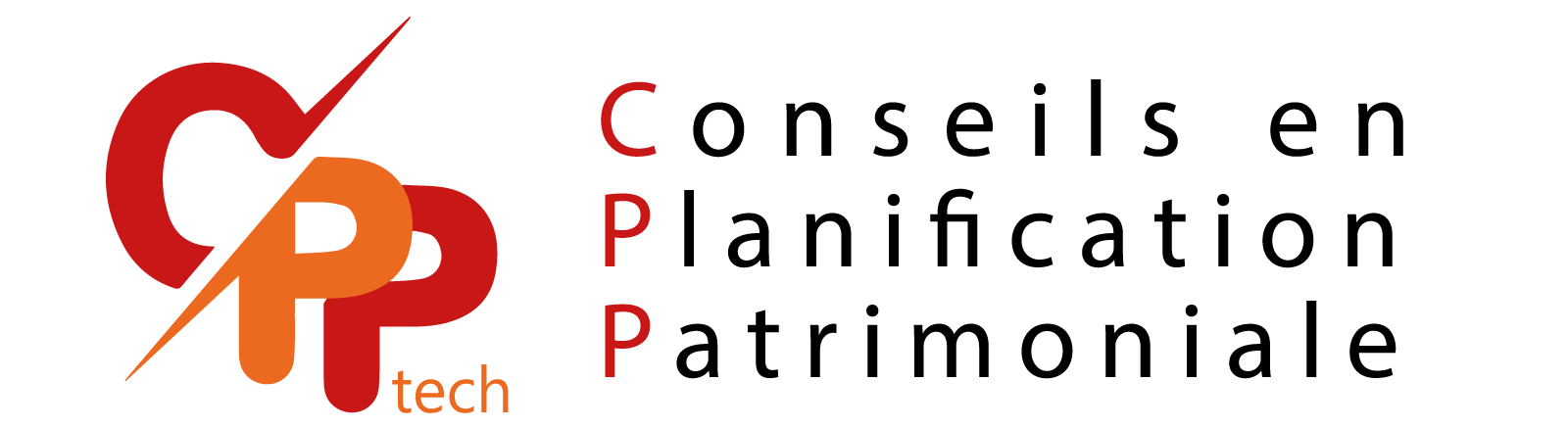Parmi les structures contractuelles, l’annexe occupe une position particulière.
L’annexe se définit comme quelque chose qui se rattache accessoirement à une chose plus importante. Elle constitue donc une manière dont les parties d’un tout sont agencées entre elles.
Le principal est une partie, l’accessoire en est une autre. Bref, en un mot comme en cent, l’annexe est une structure.
Cette caractérisation posée, il convient d’abord de constater le phénomène de l’annexe puis d’étudier son régime juridique. Le constat du phénomène est simple: l’annexe est présente partout. On évoque pêle-mêle l’annexe d’une loi l’annexe d’un acte administratif et évidemment l’annexe d’un contrat. S’agissant de l’annexe d’un contrat, celle-ci gouverne tous les types de contrats, du simple contrat n’intéressant que deux parties au contrat collectif. Il n’est ainsi pas rare qu’au règlement de copropriété, il soit annexé la nomination du premier syndic de copropriété. Quant aux accords de volonté entre deux personnes, la diversité des annexes est tellement impressionnante qu’il est impossible de toutes les énumérer. On peut citer entre autres les procurations, les documents d’urbanisme, les justificatifs divers et variés. L’annexe est à ce point répandue qu’il n’est pas rare qu’à un contrat soit annexé un autre contrat. C’est ici l’annexe pu l’histoire des poupées russes!
Du point de vue du droit de la preuve, l’annexe peut servir à l’établissement des différents actes qui composent l’ordonnancement juridique. Les rédacteurs l’utilisent à foison pour l’établissement des actes sous seing privé. Il n’est par exemple pas rare d’annexer un état des lieux à un bail à usage d’habitation. De l’autre côté de la chaîne des actes, au niveau des actes authentiques, les notaires usent et abusent de la technique. Il est fréquent qu’une vente d’une maison à usage d’habitation comporte plus de trente annexes. Le record est détenu sans doute par la vente d’un lot de copropriété pour laquelle la loi Alur[] impose l’annexe des trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que de l’ensemble des modificatifs au règlement de copropriété. Le notaire rédacteur joue même à l’équilibriste pour expliquer une telle lourdeur lorsque le lot vendu est un garage! Quant au dernier invité des actes, à savoir l’acte sous signature juridique, les avocats s’emploient également à utiliser l’annexe. Une convention de divorce comporte ainsi de nombreux documents qui y sont annexés.
Pourquoi au fond un tel succès ? Parce que la loi y incite, au moins indirectement. En transférant ses propres compétences à des acteurs privés, l’État se complaît à leur faire endosser la charge de formalités plus ou moins contraignantes. La sécurité juridique qu’il ne peut plus assurer, il la fait supporter par d’autres, à bon compte.
La récente réforme portant déjudiciarisation du divorce en est un exemple topique. La convention comporte expressément, à peine de nullité, les noms des parties, celui des avocats, l’accord des époux, les modalités de règlement des effets du divorce, l’état liquidatif, l’information des mineurs. Voilà donc un nouvel acte solennel, un de plus.. Vous me direz que la solennité porte ici sur le contenu de la convention, non sur l’obligation d’annexer. Sauf que la nullité fulminée fait craindre le pire au rédacteur, s’il ne garde pas la preuve de la mention obligatoire. Il a dans ce cas recours à l’annexe. La justification de l’identité d’une personne ouvre ainsi l’accès à la pratique de l’annexe de son état civil. La loi sur la déjudiciarisation du divorce est symptomatique des lois de déjudiciarisation. Il y a certes transfert de compétence. Il y a surtout transfert de responsabilité. Et les professionnels essaient de se protéger comme ils peuvent. D’où l’annexe !
La loi sur la déjudiciarisation du changement de régime matrimonial fournit un autre exemple de ce phénomène. Pour s’assurer que les enfants majeurs n’ont pas fait opposition au changement de régime, le professionnel de droit rédige un acte de dépôt de pièces auquel il annexe…des pièces. Mais la responsabilité des professionnels ne s’est pas développée avec les lois de déjudiciarisation. Elle existait et s’est développée bien avant. Et, par contrecoup, elle a favorisé le développement des annexes, que les rédacteurs ont vues comme un moyen de protection. Un simple exemple suffit à le démontrer.
Curieusement, un tel développement de l’annexe n’a pas suscité une grande curiosité de la part de la doctrine. On peut certes compter sur la fameuse définition de Defrénois. Celui-ci a défini l’annexe comme la jonction d’une pièce à un acte, lorsque cette pièce sert de justification ou d’appui à une déclaration, à une énonciation ou lorsqu’elle est exigée par la loi. Mais hormis cette définition quasi historique et quelques articles, l’annexe n’a guère suscité d’enthousiasme.
Pourtant, le lien entre le principal et l’accessoire est assorti d’une limite. Si l’acte est authentique, l’annexe conserve sa nature d’acte sous seing privé. Un acte sous seing privé annexé à un acte authentique demeure un acte sous seing privé.